« En même temps, cette personne l’a bien cherché. » Cette phrase vous est-elle familière ? Elle semble fréquemment employée dans des situations de harcèlement moral au travail.
Le harcèlement : qu’est-ce que c’est et pourquoi on en parle ?
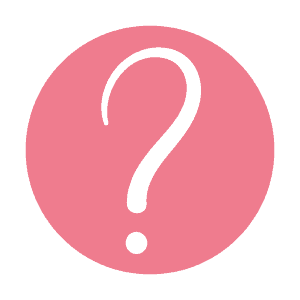
Diffusion de rumeurs, dénigrement, mise au placard et refus de communication, conditions de travail dégradées, critiques incessantes, sarcasmes répétés, humiliation publique, dévalorisation du travail, attribution de tâches ingrates sans rapport avec les fonctions, insultes, menaces, et actes de violence verbale sont autant d’exemples de ce que peut constituer le harcèlement moral. Ce phénomène a été qualifié par Marie Pezé de « pathologie de la solitude ».
En 2022, la cour d’appel de Paris a reconnu l’existence d’un « harcèlement moral institutionnel » dans l’affaire dite des suicides à France Télécom. En effet, l’organisation du travail et les techniques de management employées ont conduit à un harcèlement moral systémique. L’ex-PDG de France Télécom Didier Lombard et Louis-Pierre Wenès ont été condamnés à un an de prison avec sursis.
Le harcèlement moral est interdit en France par le Code du travail et le Code pénal. Le Code du travail stipule : « Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Le harcèlement peut être reconnu indépendamment de l’intention de son auteur. Dès lors, il peut être constitué même sans volonté de nuire, résultant de faits commis involontairement.
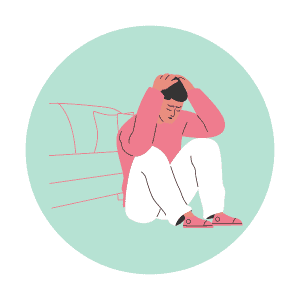
Violence, silence et solitude
Les situations de harcèlement sont de plus en plus reconnues et médiatisées, mais il reste difficile d’en sortir. Pourquoi ? Pourquoi aussi peu de personnes interviennent-elles lorsqu’elles sont témoins de harcèlement, donnant à ce phénomène le nom de « pathologie de la solitude » ? Pourquoi un tel silence entoure-t-il le harcèlement ? Et pourquoi avons-nous tendance à blâmer les victimes ?
Pascale Desrumaux, professeure de psychologie du travail et des organisations à l’Université de Lille, a publié en 2007 un article intitulé Harcèlement moral au travail, survictimation et problèmes du harceleur : quand les victimes sont jugées aussi responsables que leurs harceleurs.
Son étude explore les impacts des caractéristiques individuelles de la personne harcelée, de l’agresseur, ainsi que des circonstances sur les évaluations de l’équité, de la responsabilité, et de l’intention d’aider. Les participants ont évalué, à partir de scénarios de harcèlement moral, la justesse de la situation, la part de responsabilité attribuée à l’agresseur et à la victime, ainsi que la probabilité d’intervenir dans de telles circonstances.
Les résultats de cette étude offrent une grille de lecture utile pour mieux comprendre ces phénomènes. L’objectif de cet article est de présenter ces résultats de manière simplifiée.
Précautions
- Qualification des faits : Seul un juge peut qualifier des faits de harcèlement. Cette notion est définie par le Code du travail et le Code pénal. Il est préférable d’utiliser des termes comme « comportements ou propos violents » plutôt que d’accuser de harcèlement sans fondement : accuser faussement son employeur de harcèlement moral peut justifier un licenciement pour faute grave. Il est donc conseillé de consulter un avocat avant d’engager une action en justice.
- Terminologie : Cet article utilise les termes de « victime » et d’« agresseur ». Attention toutefois à ne pas s’enfermer dans une vision binaire du harcèlement. Il est essentiel d’analyser la situation avec du recul.
- Conseils juridiques : Les suggestions évoquées en conclusion de l’article ne constituent pas des conseils juridiques. Pour garantir le respect de vos droits, il est recommandé de consulter un avocat.
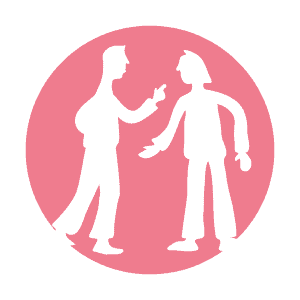
« C’est aussi sa faute, surtout si ça lui est déjà arrivé par le passé »
De manière générale, les participants à l’étude de Desrumaux (2007) jugent la victime responsable de ce qui lui arrive. La chercheuse explique que l’agresseur et la victime sont souvent confondus en ce qui concerne la responsabilité.
L’erreur fondamentale d’attribution (Ross, 1977) est un concept psychologique qui décrit notre tendance à sous-estimer l’influence de la situation, du contexte ou des circonstances sur le comportement des autres et à surestimer les influences personnelles, telles que leur personnalité ou leurs caractéristiques propres. En d’autres termes, nous avons tendance à attribuer le comportement des autres et ce qui leur arrive à leurs traits personnels plutôt qu’à des facteurs externes. Lors de situations de harcèlement, il peut y avoir une « surévaluation systématique de la responsabilité de la victime, associée à une sous-estimation des facteurs organisationnels » (Faulx et Guezaine, 2000, p. 140).
La victime est jugée d’autant plus responsable dans les situations suivantes :
- Survictimation :
La victime est présentée comme ayant déjà été harcelée par le passé, ce qui constitue un cas de survictimation. Lorsque cette situation se produit, les participants la jugent davantage responsable de ce qui lui arrive, estiment que la situation est plus juste que si elle n’avait pas déjà été victime, et expriment moins d’intention de lui venir en aide. « Tout se passe comme si le fait d’être ciblée une deuxième fois confirmait qu’elle adoptait un rôle de victime, provoquait des comportements agressifs chez autrui et impliquait sa responsabilité » (Rudolph et al., 2004, cité par Desrumaux, 2007). Pour Desrumaux (2007), on peut parler d’un raisonnement du type « ce n’est pas la première fois qu’elle est harcelée, donc elle doit bien y être pour quelque chose ». - Explication par la victime de l’agression par des éléments liés à elle-même (causalité interne) :
La victime explique ce qui lui arrive par des éléments personnels plutôt que par des éléments liés au contexte. À l’inverse, lorsqu’elle attribue le harcèlement subi aux circonstances ou au contexte, elle est jugée moins responsable de la situation.
Selon la théorie du monde juste (Lerner, 1980), face aux événements de notre vie, nous adhérons à trois croyances : le monde est juste, bienveillant, et l’Homme est bon. Lorsqu’un témoin ne peut pas agir face à ce qui arrive à une victime de harcèlement, il souhaite maintenir cette croyance en un monde juste. Il doit se protéger de l’idée que lui aussi pourrait être potentiellement victime de harcèlement un jour. Ainsi, ce témoin cherche à se persuader que la victime est différente de lui, et qu’elle est en partie responsable de ce qui lui arrive (Lerner et Simmons, 1966 ; Lerner, 1980).
En conséquence, lorsqu’ils ne peuvent réagir, les témoins ont tendance à attribuer une part de responsabilité à la victime.
L’impasse du silence
Lorsque la victime est survictimisée, c’est-à-dire qu’elle est présentée comme ayant déjà été harcelée, et que l’agresseur n’est pas perçu comme ayant des problèmes, les participants sont moins enclins à lui porter secours. Cela aide à comprendre comment le silence entourant la problématique du harcèlement contribue à maintenir la victime dans cette situation : lorsque les témoins ne sont pas informés des comportements de l’agresseur et de ses éventuels problèmes psychologiques, ils sont moins disposés à aider la victime qui évoque le harcèlement subi. Desrumaux (2007) explique alors que « l’intérêt pour un harceleur de faire obstacle à la transmission des informations le concernant est évident, puisque cela pourrait déclencher une intervention ».
Les participants se montrent relativement modérés quant à la responsabilité de l’auteur du harcèlement. Toutefois, lorsqu’il est perçu comme ayant des problèmes psychologiques, l’intention d’aide augmente. De même, les participants sont plus enclins à aider la victime si l’entreprise est en difficulté économique. Cependant, lorsque l’entreprise est en situation de précarité, l’agresseur est également perçu comme moins responsable du harcèlement.
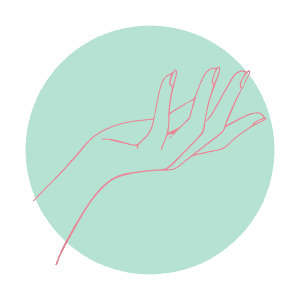
Se faire aider : ce qu’il faudrait dire et ne pas dire
Selon Weiner (1996), lorsque l’on ne considère pas la victime comme responsable de ce qu’elle subit, on est plus enclin à lui venir en aide. L’étude de Desrumaux (2007) permet de tirer quelques conclusions sur la posture à adopter lorsqu’on est victime et qu’on cherche à sortir d’une situation de harcèlement. Soyez cependant prudent : il ne s’agit que des résultats d’une seule étude et non d’une liste à suivre strictement.
- Évoquer la personnalité ou les problèmes de l’agresseur : Parlez des comportements qu’il vous a fait subir et des propos qu’il a tenus. Attention toutefois à fournir des exemples concrets et à ne pas le qualifier directement de « pervers narcissique ». Le trouble de la perversion narcissique peut être identifié chez certains agresseurs, mais ce n’est pas systématique. L’identification de ce trouble nécessite une analyse approfondie, et son utilisation excessive pourrait vous décrédibiliser.
- Évoquer les circonstances et le contexte : La victime sera moins jugée responsable de ce qu’elle subit en mettant en avant les causes liées à la situation plutôt qu’à sa personne.
- Éviter de mentionner le fait d’avoir déjà été victime de harcèlement : Cela pourrait amener les collègues et autres témoins à penser que, puisque vous avez déjà été victime, vous contribuez en quelque sorte aux agressions que vous subissez.
sources
Desrumaux, P. (2007). Harcèlement moral au travail, survictimation et problèmes du harceleur : quand les victimes sont jugées aussi responsables que leurs harceleurs. Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, 73, 61-73. https://doi.org/10.3917/cips.073.0061
Faulx D. et Guezaine C. (2000): Le harcèlement moral au travail, état des lieux et pistes de développement. Médecine du Travail et Ergonomie, N°37, pp. 135-147.
Lerner M. J. (1980): The belief in a just world: A fundamental delusion. New York, Londres, Peplum.
Lerner M. J. et Simmons C. H. (1966): Observer’s reaction to the innocent victim. Journal of Personality and Social Psychology, N° 4, pp. 203-210.
Ross L. (1977): The intuitive psychologist and his shortcomings : distortions in one attribution process. In L. Berkowitz (Dir.), Advances in Experimental Social Psychology, Vol. 10, New York, Academic press.
Rudolph U., Roesch S. C., Greitemeyer T. et Weiner B. (2004): A meta-analytic review of help-giving and aggression from an attributional perspective: Contributions to a general theory of motivation. Cognition and Emotion, Vol. 18, N°6, 815-848.
Weiner B. (1996). Searching for order in social motivation. Psychological Inquiry, N°7, pp. 199-216.

